La
génisse et le pythagoricien
création au Théâtre National de Strasbourg le 17 avril
2002
c
o m p a g n i e t f 2 , j e a n - f r a n ç
o i s p e y r e t
h t t p : / / w w w .
t f 2 . a s s o . f r
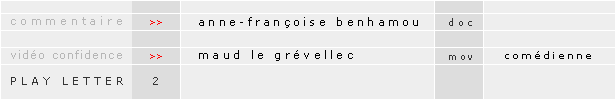
|
télécharger
les documents : sur mac, activer la touche "alt" en cliquant
sur les liens ci-dessus et choisir la commande "télécharger
le lien sur le disque". sur PC, clic droit et choisir la commande
"enregistrer la cible sous".
|
|
vous
devez posséder le lecteur Quick Time, afin de pouvoir visionner
la vidéo-confidence. téléchargez-le à
l'adresse web suivante : http://www.apple.com/fr/quicktime/download/index.html
|
|
Une
soirée de répétition avec cinq acteurs sur
le plateau : Maud Le Grévellec, François Chattot,
Pascal Ternisien, Jean-Baptiste Verquin, Clément Victor.
Rien de ce qui suit n'aurait pu être pensé si je ne
les avais pas regardés trois heures durant. C'est l'évidence
du théâtre, mais qui parfois s'oublie. Ce théâtre-là
fait qu'on ne l'oublie à aucun instant.
|
(J'aurais voulu pouvoir raconter ce à quoi j'ai assisté au Studio Kablé le 28 mars. Mais je n'y suis pas arrivée. J'essaierai donc simplement de dire pourquoi j'aime tant ce théâtre là et peut-être sera-ce une manière de dire pourquoi il est difficile à raconter.)
La plupart du temps, les metteurs en scène et les acteurs ne tolèrent
pas les intrus quand ils répètent, et leurs salles de répétition
sont fermées aux étrangers. Ici, rien de tel. Non qu'on
entre comme dans un moulin (ce qui voudrait dire que l'arrivant serait
voué à l'indifférence) - au contraire, de la façon
la plus hospitalière et la plus courtoise qui soit, on est invité
à voir ce que généralement on ne peut ni ne doit
voir. Loin de protéger le secret de fabrication, on semble ici
tenir à le montrer, à vous le montrer. A la lumière
de l'épisode des Métamorphoses qui ouvrira la séance
- la mésaventure de Tirésias, qui en avait un peu trop vu
– on ne peut s'empêcher de s'interroger sur cet étrange
et pressant désir de dévoiler la scène primitive
du spectacle, l'acte de sa conception…
Car aussi chaleureusement accueillie ait-elle été, il n'est
pas facile pour l'observatrice de savoir ce qu'elle a vu, entendu. Les
raisons de cette difficulté ? A la réflexion, elle s'est
dit que cela tenait en partie à la façon dont la répétition
se pratique ici. Le plus frappant en effet (ce qui l'avait déjà
frappée lors d'une visite pendant la préparation d'un autre
spectacle) c'est à quel point ce travail visiblement intense semble
aristocratiquement détaché de sa finalité (ou du
moins de la finalité qui l'autorise à exister socialement,
économiquement) : le spectacle. Comme si tout le monde ici cherchait,
mais surtout sans (se) fixer de but – une règle de savoir-vivre
théâtral à laquelle personne, apparemment, ne déroge
- sauf , peut-être, in petto, le metteur en scène…
(mais si c'est le cas, il ne le montre pas). Une énergie de réponse
assez phénoménale semble ici déclenchée mais
par quelle question exactement ? (Comme Jochen Gerz est actuellement exposé
à Strasbourg, je pense à son Monument aux vivants,
fait de réponses multiples à une question restée
secrète – mais ici, il s'agit peut-être plutôt
d'un point aveugle ?).
Quoi qu'il en soit ce déroulement non-téléologique
du travail est une façon de faire plutôt atypique. Car bien
souvent, sous une forme ou une autre, l'enjeu des répétitions
consiste pour une équipe à définir et redéfinir
de plus en plus précisément ce qu'elle cherche… On
sent bien qu'ici un tel ciment est conjuré de toutes les façons
possibles. Pourquoi retarder jusqu'aux dernières extrémités
la définition d'une globalité ? S'agit-il de tout faire
pour qu'elle ne soit là qu'en creux? Ou est-il crucial, par cette
espèce de jeu avec le feu (car la première approche) de
libérer radicalement les acteurs de l'effort d'être constructifs
pour qu'ils produisent un travail d'un autre ordre (déconstructif/reconstructif
?). Quoi qu'il en soit, après avoir été prise dans
l'ambiance générale, on n'a aucune envie d'opérer
une synthèse, de figer un état d'un travail, d'exprimer
un point de vue construit. Tant est forte et prenante cette sensation
que la répétition pourrait ne jamais finir, que sa vraie
justesse est d'être en elle même une machine à plaisir.
Le 28 mars au Studio Kablé, un jour gai des répétitions
de La Génisse, le théâtre m'apparaissait comme
un euphorisant. Que dire de ce qu'on a vu sous euphorisant ?
(De retour à un état plus normal, reste un mystère.
C'est la deuxième fois que j'assiste à une répétition
d'un spectacle de Jean-François Peyret, à peu près
au même moment de la gestation du spectacle, à mi-parcours.
Les deux fois je me suis posé avec perplexité la même
question : la forme finale du spectacle est-elle due de façon aléatoire
à l'achèvement du temps de recherche - comme aux chaises
musicales, où on s'assied quand la musique s'arrête et tant
pis pour ce qui n'a pas de place ? Ou cette forme a-t-elle toujours été
là sans qu'on la voie, image dans le tapis ?)
Mais si l'observatrice a tant de mal à tenir un discours sur ce
qu'elle a vu, ce n'est pas seulement parce que quelque chose, de l'intérieur
de ce travail, résiste au commentaire ou insinue dans toute tentative
de le commenter des virus perturbateurs et un peu moqueurs. C'est avant
tout parce que cet art-là, étrangement, l'a toujours renvoyée
à quelque chose de très intime, à cet endroit où
le vieux désir humain de comprendre quelque chose du monde est
en elle chevillé au corps depuis toujours – le complexe de
l'enfant d'éléphant si on veut (tiens, une autre métamorphose…)
De ce désir de savoir et de sa nature secrètement pulsionnelle,
ce théâtre-là dit beaucoup – et après
l'avoir approché sous sa forme mathématique et philosophique
c'est à sa racine, la forme mythologique, qu'il s'en prend.
Et durant cette soirée au Studio Kablé où l'invitée
est arrivée fatiguée, sortant d'une autre répétition,
c'est encore une fois la même sensation troublante et joyeuse que
quelque chose d'essentiel à soi, et de profond, se trouve attrapé
là. Une chose difficile à définir qui pourrait être
justement ce qui dans l'activité de la pensée (ici mythologique)
et dans l'aventure du langage vient secrètement d'un état
du corps. C'est pourquoi le plus important, parce que le plus émouvant,
dans cet agencement complexe de matériaux énormes et divers
et de compétences croisées, c'est pour l'invitée
de ce 28 mars, cette sensation : le rapport très particulier des
corps aux mots que produit cet agencement, et qui rend ces spectacles
reconnaissables entre tous. Car la tendresse et la férocité
des acteurs pour ce verbe qui leur est confié pour en faire leur
symptôme le plus intime font de ce théâtre une merveilleuse
machine à (ré)érotiser la pensée.
Anne-Françoise Benhamou