La
génisse et le pythagoricien
création au Théâtre National de Strasbourg le 17 avril
2002
c
o m p a g n i e t f 2 , j e a n - f r a n ç
o i s p e y r e t
h t t p : / / w w w . t f 2 . a s s o
. f r
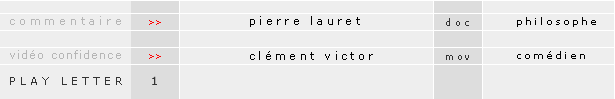
|
télécharger
les documents : sur mac, activer la touche "alt" en cliquant
sur les liens ci-dessus et choisir la commande "télécharger
le lien sur le disque". sur PC, clic droit et choisir la commande
"enregistrer la cible sous".
|
|
vous
devez posséder le lecteur Quick Time, afin de pouvoir visionner
la vidéo-confidence. téléchargez-le à
l'adresse web suivante : http://www.apple.com/fr/quicktime/download/index.html
|
OVIDE.
Souvenir d’école. Poète galant et mondain, il fut exilé
par Auguste sur les bords de la Mer Noire, en 8 ap. JC, pour avoir vu
ce qu’il aurait eu mieux fait de ne pas voir (rite de divination
pythagoricien, intolérable à un prince seul maître
de l’avenir et protecteur de la religion traditionnelle ; ou partouze
chez l’imperator ? Fut-il puni d’être visionnaire ou voyeur
?). Sa carrière, commencée dans une aimable licence, finit
dans les pleurnicheries -mais aussi avec un traité sur la pêche
en Mer Noire (Les Halieutiques, poème didactique). On ignore
si, conformément à l’enseignement anti-spéciste
de Pythagore, Ovide s’abstint de manger du turbot, poisson particulièrement
intéressant du point de vue de la métamorphose, on l’apprendra
dans la pièce ; car somme toute son profil devient sa face. Comme
les femmes chez Picasso, peintre de minotaures et personnage (?) de la
pièce.
Au début les amours, à la fin les tristesses, entre : les
Métamorphoses (15 livres, 11995 hexamètres dactyliques).
Fortune considérable du livre : table de chevet de Shakespeare,
Leonard, Monteverdi, Poussin etc…; envahit l’Amérique
avec le Mayflower. Bref, tout ce qui compte dans la culture occidentale
jusqu’au 18° siècle connaît les Métamorphoses,
les récite, s’en inspire, vit avec et un peu dedans. Sans
doute parce que c’est un compendium commode de la mythologie greco-latine.
Mais pas seulement.
Et maintenant ? Le texte est à peu près mort ; il n’existe
plus que comme objet savant pour quelques professeurs de langues anciennes.
Même les spécialistes de Shakespeare ne connaissent pas vraiment.
Pour une fraction du public lettré surnagent des noms propres,
associées à des histoires imprécises. On se souvient
que la belle a été changée, mais était-ce
en langouste ou en mangouste (ça dépend du copiste). Pour
le reste (à peu près tout le monde) : rien. Absolument rien,
je crois. Donc, on a un monde qui a disparu. Une part non négligeable
de la culture -forme complexe et efficace de la mémoire- ne fonctionne
plus comme mémoire et ne subsiste que comme monument et document
; vestige ; source.
Quelle hypothèse sur cette disparition (bien naturelle par ailleurs
-voir dinosaures, homo habilis, homo neanderthalis, etc…) ? Les Métamorphoses
constituent un complexe textuel très hétérogène.
C’est une mythographie. Ovide avait compilé les mythographes
alexandrins. Mais qu’est-ce qu’un mythe ? De quoi ça
parle, et comment ? Ce n’est déjà pas très simple.
Cette mythographie s’organise en une histoire du monde : chaos, genèse,
déluge, histoire mêlée des hommes et des dieux qui
conduit -dans un certain désordre chronologique- de Thèbes
à Troie puis à Rome et à Auguste (Ovide lui fait
de la lèche dans l’espoir vain d’être rappelé
du Pont). Enfin, le tout est placé au Livre XV dans la perspective
du savoir pythagoricien. Certes, le Pythagore d’Ovide n’est
pas très solide théoriquement. C’est une sorte de gourou
végétarien qui prouve le devenir incessant de tout et la
métempsychose par le changement des saisons, le souvenir de sa
propre participation à la guerre de Troie, et autres arguments
hujus farinae. Il reste que le chant ovidéen se place sous l’autorité
d’un savoir sur la nature, les origines, les principes ou causes,
les lois mathématiques du changement, et la place de l’homme
dans l’univers (ou quelque chose comme ça). On ne peut séparer
ici la fable et le discours savant, car il est à supposer que la
parole mythique atteignait ou touchait ses destinataires par leur mélange
obscur et complexe. On a donc un répertoire de fables qui vaut
aussi comme grand discours traitant du vivant, plus particulièrement
du rapport des hommes aux dieux et aux animaux, dans une optique naturaliste.
Au I8°, ce discours devait perdre de sa puissance -et du coup les
fables perdre de leur enchantement. Parce que le divin ne se prononce
plus de la même manière ; parce que la psycho-physiologie
de Descartes, et sa métaphysique (l’âme et le corps)
; parce que le vivant s’impose comme le nouveau défi à
la connaissance mécanicienne de la nature (querelles du fixisme
et du transformisme, de l’évolution et de l’épigenèse,
etc…)
Aujourd’hui la métamorphose se dit évolution ou mutation.
Le vieux rêve pythagoricien est devenu chez D’Arcy Thompson
la géométrie du rapport des forces et des formes ou de la
transformation coordonnée d’un tout et de ses parties (la
mathématisation de la loi de subordination des organes de Cuvier).
Cela signifie-t-il que maintenant qu’on a la science, la fable n’a
plus à prendre en charge la connaissance ? La connaissance ayant
atteint son régime de vérité, la fiction accomplit
ce mouvement pour son compte, les discours rejoignent leurs lieux naturels
respectifs, avec prière de n’en plus sortir sauf à
produire des monstres -effrayants et insignifiants. Il y a là de
quoi plaire aux Aufklärer -enfin une humanité éclairée,
qui ne verrait dans la science que la science et ne la verrait que là
où elle est- et aux humanistes : la science s’occupant de
la matière, l’unique objet des arts, notamment du théâtre,
est donc l’âme. La technique fournit l’électricité
et les machines, bref le confort, et les muses se réservent le
supplément d’âme.
Pas si vite. Tout cela est trop simple, trop naïf ou trop empressé.
Une seule chose est sûre : entre Ovide et nous, ce qui a changé,
c’est la religion, le rapport des hommes et des dieux. Là,
un partage net et étanche : le discours scientifique (pas des scientifiques)
est pur de toute religiosité. Mais, en dépit d’antiques
espérances, cela n’a pas du tout réglé la question
de la superstition ; ni celle de la croyance (et donc de la croyance en
la science). Pour le reste, il faut voir.
Depuis
quelques temps Jean-François Peyret s’ingénie à
construire des objets permettant la rencontre de vieilles histoires et
de sciences jeunes ou moins jeunes ; de textes anciens et de machines
modernes. Hier Racine et Descartes (qui lui voulait expurger la science
de la poésie, ce qui ne l’empêchait pas de conseiller
de lire sa physique comme un roman) ; ou Faust et Jean-Didier Vincent.
Aujourd’hui Ovide et Alain Prochiantz. De tels objets sont par vocation
complexes. Mais c’est une complexité très légère
; très joueuse.
La complexité vient évidemment de l’hétérogénéïté
du texte : récit, discours, théorie, fable. On passe de
la néoténie à Deucalion et Pyrrha, du prion à
Io, et cette hétérogénéïté est
plaisamment productive : parce qu’elle requiert une invention perpétuelle
de la mise en scène pour contourner les écueils du didactique,
de l’exposé scientifique, de l’illustration, et pour
assumer le narratif ; et parce qu’elle suscite une écoute
toujours surprise, décalée, et fraîche. La mise en
scène s’oblige à la trouvaille, et active un certain
fonctionnement de l’esprit : l’association, la corrélation,
la connexion. Le Witz.
Mais le texte n’est qu’un élément de l’objet
théâtral, qui comprend aussi : postures, masques et voix,
bien sûr ; lumières ; images video ; musique. Rien n’indique
qu’un de ces éléments ait toujours la prééminence
sur les autres, en assumant la charge de la continuité et du sens.
Le texte n’est pas, ou pas toujours, le gène dominant du spectacle.
Une certaine sacralisation du texte au théâtre présuppose
que le texte est une essence, l’enjeu du spectacle étant alors
de le rejoindre et de le manifester ; et qu’il existe comme un système
fermé dont la vie ne dépend pas de ses échanges avec
son milieu. Le jeu se met alors au service du texte. Mais dans La génisse
et le pythagoricien, le texte n’est rien de sacré, étant
lui-même un assemblage de textes différents dans leurs méthodes
et leurs intentions. Peut-être ne faut-il pas trop, ou toujours,
prendre les textes au sérieux. Peut-être aussi faut-il laisser
aux textes, quels qu’ils soient, et surtout les textes scientifiques,
quelque chose de vaguement incompréhensible ou incongru : qu’on
ne sache pas exactement ce qu’ils font là, et qu’en penser.
Partons donc de l’hypothèse que le texte se met au service
du jeu. C’est là d’ailleurs beaucoup plus l’énoncé
d’un problème qu’une formule magique ou un principe de
poétique. Méfions-nous des principes de poétique.
Pour compliquer encore l’objet théâtral, le décor
n’est pas d’un mince secours. Tout metteur en scène un
peu sérieux hait le décor servile ou imitatif, la tenture
et le carton-pâte. Le décor doit ne pas être (plateau
nu) ou exister fortement. Donc faire chier (plan incliné à
20%, plateau recouvert de mou de veau ou de coquilles d’oursins).
Dans cet esprit, Peyret et Nicky Rieti ont conçu un dispositif
bifrontal où la salle est divisée en deux par une sorte
de membrane, susceptible de s’ouvrir plus ou moins, et qui quand
elle est complètement fermée ne laisse entre les deux côtés
qu’une communication sonore. Comme on sait, une membrane sépare
et relie, filtre et laisse passer. Bon. La scénographie est tellement
visible que mieux vaut ne pas trop en parler.
Et ça fonctionne ?
Séquence
3. La mort de Penthée. La scène est à Thèbes.
Le culte de Bacchus, fils de Jupiter et Sémélé, se
répand comme une invasion panique (Walter F. Otto, Dionysos).
Penthée, petit-fils de Cadmos le fondateur de la ville, s’insurge
contre cette religion nouvelle, dont l’effet patent est de libérer
la jouissance des femmes. Discours : “Thébains, Thébaines…”
Le comédien, Jean-Baptiste Verquin, figure une sorte de De Gaulle
qui aurait des vapeurs. Juste avant dans la séquence, il faisait
Junon, la légitime (la vieille vache) que Jupiter ne cesse de tromper
avec des jeunesses (des génisses). Sous le politicien conservateur
perce le souvenir de la rombière inquiète de la jouissance
de son sexe. Métamorphose, polymorphie. Penthée veut faire
mettre à mort Acétès, un marin coupable d’avoir
introduit le culte nouveau. Cet Acétès (qui n’est autre
que Bacchus) raconte sa vie. Le récit est distribué sur
deux comédiens de part et d’autre de la membrane. Multiples
effets du procédé : le texte est autonomisé, puisqu’il
émane de deux sources distinctes ; et pluralisé, car il
n’y a pas identité des deux côtés. Les comédiens
sont détachés des personnages qu’ils endossent tout
au long du spectacle (métamorphoses). L’adresse aux spectateurs
installe une intimité, ou une complicité (très provisoires).
L’effet d’écho (nymphe, amoureuse de Narcisse) est ici
plutôt comique, mais ailleurs il majore la poéticité
du texte. Etc…
Acétès, redevenu Bacchus, fait déchiqueter Penthée
par sa propre mère, Agavé, et ses tantes Ino et Autonoé,
à la tête d’une troupe de bacchantes. Récit dit
par Clément Victor.Tout en racontant cette histoire, il ôte
son costume noir et sa veste jaune, sous lesquels on découvre une
minirobe et des chaussettes vertes -car juste après il sera Myrrha
(Livre X) transformée en arbre pour avoir couché avec son
père et en avoir conçu Adonis ; et dans Les Bacchantes
d’Euripide, Penthée est transformé en femme avant sa
mort.
Le passage est très frappant. Le récit est tragique, la
mise en scène fait passer ce tragique dans le divertissement comique,
l’impromptu moliéresque, les plaisirs de l’île
enchantée. Il est vrai que le monde de l’Olympe est comique.
Passé le drame de la théogonie, les dieux ne peuvent être
tragiques, puisqu’ils sont immortels. Rien de vraiment grave ne peut
leur arriver. D’où beuveries, oisiveté, tromperies,
vaudeville bourgeois, et petits jeux cruels avec les hommes. Il est vrai
aussi que sous sa figure d’Acétès Bacchus a tout l’air
d’un brave type. Mais son jeu à lui va un peu loin, quand
même. Et cet aspect monstrueux de la mort de Penthée doit
passer. L’impromptu est une autre manière de dévoiler
le tragique toujours associé à Dionysos. On peut parler
ici d’un théâtre indirect, qui se tient toujours
dans un rapport oblique aux textes. Dans un tel théâtre,
la fonction du narrateur est déclinée dans tous les avatars
imaginables. Mais l’approche indirecte n’est pas le second degré
-le bénéfice artistique et intellectuel serait dérisoire.
Ainsi, dans ce récit de la mort de Penthée, les spectateurs
voient un acteur qui se travestit comme un guignol ; mais une certaine
mélancolie du ton signale que le personnage, lui, voit l’horreur
: une mère aveuglée par le fanatisme religieux déchiquète
son propre fils. Climax
Tout le spectacle me paraît maintenir un rapport très vif
à la question de la croyance. Déjà, rien de
religieux dans le travail : pas de fausse communauté, pas de rituel,
pas de chef qui tout en se tenant au milieu des autres rappelle à
l’ordre du vrai, nulle référence à quelque mission
sacrée. Pour faire du bon théâtre, il faudrait commencer
par ne plus croire au théâtre. N’est-il pas clair maintenant
qu’on a beaucoup trop cru en la science ? Depuis la fin de la Renaissance
on a beaucoup trop attendu de la science, de la technique, des machines,
parce qu’on les a inscrites dans le schème du progrès
: histoire de la victoire progressive de la raison humaine sur les erreurs
et les illusions du sujet, et sur les peines et douleurs découlant
de notre rapport objectif à la nature. A chaque conquête
de la science l’attente renaît, on scrute l’horizon de
la félicité par la connaissance et l’artifice. Un livre
de Lyotard, L’inhumain, fait à cet égard
un important travail pour désinvestir toutes les positions de croyance
liées à la connaissance : la science n’a jamais répondu
à l’intention d’améliorer et de simplifier l’existence
humaine, et elle n’a jamais eu vraiment cet effet. Elle est plutôt
une manifestation de la lutte contre l’entropie, dont l’homme
est le vecteur et non le maître. Qu’est-ce que l’homme
? (question récurrente, et moquée dans cette insistance,
de la deuxième séquence de la pièce). Ni une origine,
ni un résultat, “un transformateur assurant, par sa techno-science,
ses arts, son développement économique, ses cultures, et
la nouvelle mise en mémoire qu’elles comportent, un supplément
de complexité dans l’univers.” (L’inhumain,
p. 54). Trans-formateur, méta-morphoses.
Mais c’est à tout discours théorique qu’on adresse
ces questions où se trahit sans doute un désir de croire
: à quoi cela sert-il ? En quoi cela nous interpelle ? Quelle vérité
sur nous ce discours (la génétique, la théorie de
l’information, la psychologie cognitive, etc…) recèle-t-il
? Enfin, quel usage pouvons-nous en faire hic et nunc sur la scène
du théâtre, miroir de la scène sociale ? Ces questions
ne sont évidemment pas absurdes, et ce qui serait absurde, ce serait
de se satisfaire d’un rapport complètement arbitraire ou mondain
à la connaissance. Mais elles sont mal posées, irréfléchies,
et pour l’heure improductives. Elles prétendent sans cesse
réveiller une sorte d’urgence dans notre rapport au savoir.
Or, rien ne me paraît plus urgent que de suspendre cette urgence,
afin de nous disposer à une autre fréquentation des sciences
et des techniques. Le théâtre de Jean-François Peyret
est salubre à cet égard. Il nous allège de certaines
questions usées, et fait de la place pour d’autres.
Séquence 3, suite. Dionysos (François Chattot) et
la bacchante (Maud Le Grévellec). On atteint le sommet du ludique
: Dionysos metteur en scène dirige une jeune comédienne
dans une scène d’Euripide, en élucubrant sur la topique,
héritée de Nietzsche, du dionysiaque, du tragique, etc…
(Cocasserie absolue du jeu de François, qui porte parfois le comique
de l’entreprise à un point irrésistible ; bacchanale
parfaite de Maud. Un plaisir de théâtre immédiat.)
Face au désir et à la réalité du jeu, le metteur
en scène est démasqué comme un fâcheux, qui
interrompt et empêche, avec ses explications psychologiques et philosophiques
importunes. Peyret lui-même comme metteur en scène a une
manière d’être bien à lui. Il n’a pas de
place assignée, il se balade, on ne sait pas trop où il
est -donc ce n’est jamais le point de référence ou
le lieu du sens. En plus il n’a pas le texte. On ne peut guère
parler de “direction” d’acteurs -il laisse jouer, sans
directives ni explications de textes. Cependant tout cela n’a rien
d’énigmatique, on n’a pas affaire à un mage !
Mais revenons au fâcheux. Metteur en scène et professeur,
Peyret met à mal les positions artistiques qui se coulent dans
des postures pédagogiques (le peintre et son modèle, petite
séquence où Pascal Ternisien s’épuise dans des
proclamations esthétiques) : comme si l’art, le “faire”,
le geste artistique faisait mauvais ménage avec le discours. Et
dans ce mauvais couple, c’est évidemment le faire qui est
intéressant.
Mais comment parler d’un problème avec les discours, alors
que ce théâtre convoque, rassemble et donne à entendre
les discours les plus divers ? Assurément Peyret est un philologos.
C’est donc de certains discours qu’il se moque, ou d’un
certain usage du discours. Ainsi en écrivant sur lui est-on sûr
de lui déplaire, de le faire rire ou bailler. Qu’est-ce qui
ne va pas dans le discours de la poétique, de la théorie
esthétique ? C’est sans doute qu’il est prescriptif plutôt
qu’actif ; qu’il ne prétend faire sens qu’en donnant
une leçon ; et qu’il ne donne rien à connaître
parce qu’il veut un peu trop faire comprendre.
Un des effets du dispositif bifrontal (écho, reprises, tuilage)
est que souvent les significations y sont portées par une sorte
de rumeur. Il devient alors impossible au spectateur d’accaparer
le sens. Le spectacle livre du sens, mais sans ses implications : il n’est
pas idéologique. Le sens peut être abordé partiellement,
légèrement, ironiquement, comme Montaigne en usait avec
les auteurs classiques, et au fond avec tous les objets susceptibles d’occuper
sa pensée sans l’habiter obsessionnellement. C’est l’intention
idéologique qui alourdit le sens. Il est très agréable
d’être délivré de cette lourdeur (même
si cet agrément n’est pas toujours compatible avec la position
d’observateur chargé d’un commentaire).
On ne peut pas parler d’un théâtre d’avant-garde,
car il n’y a ni provocation ni coup d’éclat. C’est
plutôt un théâtre de recherche, qui combine
des éléments hétérogènes, non pour
proposer une lecture, mais pour faire un objet ; et même un monde,
un cosmos, avec ce que cela suppose d’ordre et de chaos, de hasard
et de nécessité, de préméditation et d’aléatoire.
Une mimesis de la nature, non de la praxis, et qui s’accorde à
son propos : la méta-morphose, le passage d’une forme à
l’autre, l’engendrement des formes. Où l’on se demandera
si, à l’inverse des formes naturelles selon D’Arcy Thompson
et les pythagoriciens, le propre de la forme esthétique n’est
pas de refuser la simplicité et la symétrie, de côtoyer
toujours l’informe dans un jeu perpétuel entre stabilité
et instabilité (comme dans la théorie kantienne de l’esthétique,
dont les deux notions centrales sont la forme et le jeu).
Ce mode de spectacle requiert une attention singulière. Il faut
accepter, donc se plaire à, une saisie partielle et sélective
; laisser s’opérer une sélection naturelle des éléments
du spectacle, ce qui peut déranger notre désir de savoir
et de comprendre. Je pense que le spectacle ne veut pas provoquer des
impressions, mais des connexions. Il n’est plus dans l’esthétique
du choc propre à la modernité. Nous n’avons plus besoin
de nous faire tabasser le cervelet, la connexion suppose plutôt
de petites déstabilisations de l’intellect, et par exemple
de l’humour.
Une vision absolument matérialiste du monde peut très bien
engendrer (et engendre même souvent) une posture de “résistance”.
Cf. Lyotard, ou Sobel, ou Godard. Le travail de Peyret fait penser à
Godard, parfois. Mais un Godard sans psychologie, sans morale, sans discours
sur l’art. A la résistance, ce théâtre préfère
le jeu, comme résultat et comme principe. Ludus formalis.
Pierre Lauret, philosophe